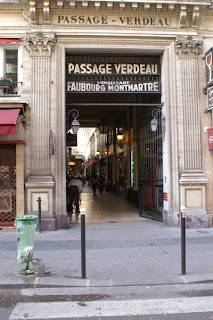Il est depuis devenu un haut lieu de la chine et du tourisme. Cependant, en cet été, l'ambiance n'est pas au beau fixe.
Le promeneur désireux de tranquillité aura intérêt à venir le lundi plutôt que le samedi ou le dimanche au Marché Dauphine, puces de Saint-Ouen. Pour vous rendre au Carré des libraires, vous entrerez au 140 rue des Rosiers et monterez à l'étage. Vous y arpenterez les pavés de bois plus ou moins bien ajustés et un univers de livres, de photos, de journaux et d'affiches s'ouvrira à vous. Le lundi, la fréquentation y est moins grande, à tel point que plusieurs boutiques sur la trentaine de libraires présents au carré, n'ouvrent plus systématiquement. C'est ce que me confirme Marie-Louise Von Krusentierna de la librairie Imago Libri, spécialisée dans le livre de photographie, qui présente également quelques enfantina, ainsi que des livres illustrés modernes des années 20 et 30.
Alors qu'elle vivait dans son pays d'origine, la Suède, elle se destinait à une carrière d'artiste peintre. Le premier contact avec la photographie lui vint lorsque son père lui offrit un appareil photo. Fort logiquement elle l'utilisa dans le cadre de ses recherches picturales. Arrivée en France il y a une vingtaine d'années pour apprendre notre langue, elle fait la rencontre d'un libraire féru de photographie... Sa passion pour le livre de photo ne la quittera plus.
Sur sa vitrine, comme chez beaucoup d'autres libraires, un petit logotype indique qu'il est interdit de prendre des photos. Lorsque je m'en étonne – une passionnée de livres de photos interdire quelques clichés ! – Marie-Louise Von Krusentierna m'explique leur réticence à voir les objectifs se braquer vers les couvertures des livres. Bien souvent, ces visiteurs armés de leur appareil numérique capturent l'image d'un livre en ayant soin de repérer la librairie qui le vend, et tentent de le négocier sur Internet. Lorsque l'affaire est faite, ils retournent se le procurer. Au mieux en l'achetant.
Internet semble bien être la cause de nombreux maux de nos amis libraires. « Internet tue le métier, soupire Marie-Louise Von Krusentierna, qui prend beaucoup de place dans les échanges ». Outre le fait de constater un appauvrissement de la qualité des ouvrages trouvés sur Internet, elle se plaint des sites tels qu'Abebooks dont l'accès n'est plus réservé aux professionnels, donnant ainsi la possibilité aux vendeurs « amateurs » de récupérer les notices descriptives effectuées par les professionnels.
 |
| The Rubayat of Omar Khayyam, trad. anglaise de Edward Fitzgerals, ill. Photos Marbel Eardley-Wilmot, 1912, London, Kegan Paul, Trench, Turbner & Co. |
Ses gros acheteurs, dit-elle, sont aujourd'hui étrangers. Il y a quatre ans encore, 80 % de sa clientèle était française. Crise économique ? Désintérêt pour le livre et pour l'écrit ?
Selon Marie-Louise Von Krusentierna, l'image est devenue un élément primordial pour le livre ancien. Mais le livre illustré ne se vend guère chez les libraires. L'exigence dans ce domaine est de rigueur. L'acheteur demande un état parfait et des ouvrages aisément remarquables. Placement financier ou valorisation par la notoriété du livre ? Et si les illustrations sont signées d'un grand nom, il part aux enchères en salle des ventes.
En ce qui concerne le livre de photos, il constitue un placement s'il est répertorié. Marie-Louise Von Krusentierna déplore une baisse de la qualité depuis les années 60, époque où l'héliogravure a été abandonnée, car le procédé est coûteux.
 |
| Ci-contre, 110 photos de Moï Wer, (fac-simile de Paris, 1931, éditions Jeanne Walther) Ann & Jürgen Wilde, 2004, édition limitée à 1000 exemplaires, ex. n°140, Editions 7L. |
Depuis les années 60, le livre de photos résultait du choix de quelques éditeurs, en faveur des quelques célébrités du genre. Depuis 2000, les éditeurs font des efforts qualitatifs. Combien de livres qui ont connu une éphémère heure de gloire ont-ils été pilonnés !
 |
| Kill by Roses, Mishima photographié par Eikoh Hosoe, 1963. |
 |
| Ashes and Snow, Gregory Colbert, catalogue de l'exposition éponyme. |
 |
| Ashes and Snow. Gregory Colbert. |
Sa voisine, de la librairie Johanne Debeire, quant à elle, propose des journaux et revues allant du début du XXe siècle jusqu'aux années 1950-60, essentiellement des gravures et des revues de mode, des journaux satiriques et des publications grand public concernant le cinéma.
Son achalandage étant particulièrement composé de gens de passage qui répondent au coup de cœur, des badauds, des touristes étrangers pour la moitié d'entre eux et des chineurs occasionnels, elle aussi observe que la clientèle jeune est peu collectionneuse.
Les amateurs recherchent les illustrateurs illustres : Mucha, Benjamin Rabier, René Gruau, Georges Barbier, les vieux numéros de Vogue, assez difficiles à trouver ; et les élégantes peu argentées ou nostalgiques, les exemplaires de Modes et Travaux et ses fameux patrons. Recherche récurrente, les illustrés concernant l'affaire Dreyfus et en cette fin de mois de juillet, est-ce la période qui est propice à cela ou l'idéologie de l'époque, des numéros sur le Tour de France en particulier et le sport en général.
 |
| Modes & Travaux, juillet 1950, n° 595. |
 |
| Frou-frou. Bonne humeur grivoise... |
 |
| ... et presse humoristique : Le Rire, Tutu, Le Pêle-mêle. |
 |
| Sans-Gêne, janvier 1932, n° 641. |
 |
| Un des monuments de la presse satirique : Le Crapouillot. Scandales de la IVe, par Jean Galtier-Boissière, n°28, 1955. |
 |
| Les aventures de la 2CV et de la grotte hantée, Hergé (Bob De Moor), 1988, Edité par Citroën. |
 |
| Le modeste catalogue Juvaquatre. |
 | |||||||||
| Le luxueux catalogue Bugatti dans son élégant étui rouge vif. |
 |
| Pompiers de Paris, histoire des pompiers de Paris, écrit par le chef de bataillon A. Arnaud, préfacé par André Maurois. Editions France Sélection, 1958, 830 pages. |
Que fait cet exemplaire massif Pompiers de Paris, avec la médaille de cette noble institution enchâssée dans la couverture dans le stand de Marc Wolf ? S'il y est également question de feu et de chaleur, les autres livres présentés sont d'une tout autre nature.
 |
| The Boothe, Jan Saudek. Coloriée à la main. |
Marc Wolf est photographe, et les personnages de papier que l'on rencontre chez lui, qu'ils soient sur les clichés des cartes postales numérotées dont il est quelquefois l'auteur, dans les tirages encadrés ou dans les illustrations des livres, sont plutôt animés d'un feu intérieur.
L'érotisme est une donnée culturelle constante aux « puces » Les librairies voisinent avec des boutiques où se dénichent corsets et dessous coquins d'époque !
A la librairie AMB, le constat est ici aussi alarmant. On vend du livre ancien. De la littérature, mais également des documents anciens. « Je vends des livres pour la décoration. Pour constituer de beaux rayonnages. Ou pour les menuisiers en recherche de techniques anciennes », me confie la charmante vendeuse qui me reçoit. Pour elle, il s'agit d'un problème culturel général. Paradoxalement, on ne peut mettre en cause le manque de bibliothèques à l'école ou municipales, parlant du désintérêt des gens et en particulier d'un public jeune pour le livre, mais la prédominance de l'image. « Il n'y a plus de bibliophiles », au sens où on l'entendait au XIXe siècle. L'écran nuit à la bibliophilie.
Le livre virtuel n'enlèverait pas de lecteurs si on sensibilisait les enfants au contact du livre.
Autre problème, le cercle vicieux du prix du livre ancien, qui grimpe à cause de la raréfaction des ventes, ventes qui diminuent à cause des prix élevés et de la volonté qu'ont les acheteurs à voir des prix conformes à ce qu'ils ont vu sur Internet. Avec Internet, les particuliers veulent rentabiliser leurs livres comme le font les professionnels.
 |
| Vies des gouverneurs généraux avec l'abrégé de l'histoire des établissemens hollandois aux Indes orientales, par J.P.I. Du Bois, à La Haye, Pierre de Hondt, 1763. |
Ce qui pourrait améliorer la situation : qu'il y ait une visibilité des libraires, du carré de libraires dans les lieux où on privilégie la culture, les musées, les expositions...
Notre société souffre que l'on n'effectue plus la mise en avant de ce qu'on pourrait appeler un peu exagérément le « patrimoine culturel », les composantes et les caractéristiques qui font la culture. Un livre n'est pas qu'un auteur, c'est aussi un ensemble de métiers dont on ne se soucie pas lorsqu'on parle d'un livre, que l'on néglige finalement.
 |
| Mon docteur le vin, Gaston Derys, aquarelles de Raoul Dufy. 1936, Préface du Mal Pétain. Ouvrage promotionnel pour Nicolas imprimé par Draeger. |
Dans une ambiance plus « pucière », la librairie Christian Journe se consacre à la bande dessinée, aux livres pour les enfants et aux anciens manuels scolaires. L'ordonnancement du stand n'a rien à voir avec « le Petit Roi », librairie du passage Jouffroy avec lequel cet ancien journaliste de L'Equipe travaille.
Ici, le chineur retrouve le plaisir de fouiller, d'exhumer d'une pile d'illustrés la perle noire, la pièce manquante recherchée ou de se laisser surprendre. Sa clientèle composée de 70 % de promeneurs pour 30 % de collectionneurs il y a seulement deux ans, la tendance était inverse. Les touristes américains reviennent, et les dames et demoiselles Japonaises achètent tandis que monsieur se montre plus réticent.
 |
| Ambiance plus typique des Puces pour le plaisir premier du chineur : fouiller. |
Autre son de cloche à La Source du Savoir, chez ce passionné d'automobile qui était présent aux 24 heures du Mans Classic et de Steve McQueen (il se vante de pouvoir réunir tous les documents iconographiques concernant la star). Affiches, photos d'acteurs, beaux livres, de quoi façonner de jolis décors. Ici on considère la plainte des autres libraires comme une conséquence de leur entêtement à ne pas vouloir changer dans le sens où le monde évolue. « Nous travaillons davantage avec une mentalité anglo-saxonne. L'intelligence c'est la capacité à s'adapter. Plus qu'une boutique, il s'agit d'un lieu de rendez-vous. La clientèle est internationale. Nous n'attendons pas que d'hypothétiques clients viennent à nous, nous allons les chercher. » Grâce à la synergie produite par d'autres activités, comme le conseil en entreprise, l'aménagement de boutiques, des actions dans le domaine de l'événementiel, les contacts privilégiés avec une clientèle choisie et fidèle se multiplient.
Alain Rodelet, quant à lui, a essentiellement une clientèle d'habitués. Présent au marché Dauphine depuis sa création en 1991, il en est l'un des initiateurs du Carré des libraires. Installé au marché Vallès qui était fréquenté par les marchands, il soumit l'idée de créer un marché grand public. Le Carré des libraires érigé sur ce qui n'était que des remises sur des terrains vagues regrouperait les vendeurs de livres et de vieux papiers.
Il détient une importante collection d'autographes, des partitions originales, des documents introuvables sur Internet puisqu'uniques.
 |
| Œuvres de Molière, reliure bicolore, Relieur Pierre Dauphin. |
 |
| Recueil des plus curieux et rares secrets touchant la médecine métallique et minérale tirez des manuscripts de feu. Mr J. Du Chesne, Ed. J. Brunet. 1641. |
Lui aussi fait un bilan sombre de la situation des libraires. Les causes de la désertion des acheteurs, il l'attribue au manque d'éducation en matière d'art. Les techniques de fabrication ne sont pas enseignées à l'école, « les jeunes ne savent pas reconnaître une lithographie d'une photocopie », assène-t-il presque par provocation. La crise, il en rend Internet responsable pour une part. « Si l'Etat ne fait rien, c'est la mort des artisans... Il n'y a pas de cohérence dans une activité où certains tiennent des livres de police, payent des taxes, des patentes, des loyers et où d'autres s'exonèrent de ces contraintes... Il faudrait imposer la TVA sur Internet ». Et « spécialiser le marché avec des conférences, des rencontres, refaire l'éducation des gens ».
Anthare de Schuyter renchérit sur ses homologues. En substance, il confie que les pouvoirs publics, Etat, municipalité ne sont guère intéressés par ces marchands peu nombreux, peu influents dans l'économie nationale, non électeurs à Saint-Ouen, les associations et syndicats de libraires privilégient le créneau le plus porteur qui est le livre rare et cher. Quant au statut d'auto-entrepreneur, il ne résout rien et ne sert qu'à enjoliver les statistiques du chômage. Il ne limite en rien la concurrence déloyale des sites marchands ou d'enchères.
Internet donne une visibilité un peu particulière de la rareté d'un livre ancien, qui réunit en un clic sur un moteur de recherche le résultat global de tous les exemplaires en vente du même ouvrage, sans garantie de son état, de manques éventuels. La notion de rareté en est bouleversée. La culture par Internet supplante celle acquise par les catalogues, que les libraires rechignent désormais à éditer.
La fonction de libraire est à l'agonie, et d'ailleurs, nombre de ceux rencontrés lors de ce petit reportage sont en passe de cesser leur activité pour partir à la retraite ou vers de nouveaux horizons. La collection devient virtuelle par le biais des appareils photo numériques. Les acheteurs se déplacent de moins en moins jusque dans une librairie, laissant la place à ces photographes du dimanche qui se contentent d'un cliché qui sera publié sur un blog ou tout simplement oublié, et finalement effacé une fois le disque dur saturé ou l'ordinateur obsolète. Ainsi que les modes, les goûts changent, mais il ne semble pas qu'ils se portent sur le livre.
Terminons cette promenade estivale par la librairie Spleen, riche en curiosités. Daniel Pitaud regrette un peu le mélange des genres, les libraires jouxtant des magasins de fringues, et pointe notamment les problèmes de transport, la grande difficulté pour le visiteur à garer sa voiture et l'insécurité. « Les Parisiens, ne viennent plus ». Il faut s'adapter à la demande des touristes. Ceux-ci recherchent des documents ou des ouvrages en relation avec leur pays, mais aussi qui ont fait la renommée de la France, la cuisine, le parfum, etc., ou qui ont trait aux expositions internationales. Les Chinois, par exemple, recherchent des pièces venant du sac du Palais d'été. Philosophe, il diversifie sa marchandise. Il a même en vitrine un revolver Remington datant de la guerre de Sécession. De quoi se flinguer !
 |
| La Racaille, de Nonce Casanova, Bois en camaïeu de Siméon, livre quatrième de L'Arabesque, Editions Rouffé, 1928. |
 |
| 30 binettes pour un franc, par Commerson et Nadar, Editions Gustave Havard. |
 |
| Almanach du masque d'or, ill. Edouard Halouze, 1921, Devambez, édité par le magasin Au paradis des enfants. |
 |
| Opéra russe à Paris, Théâtre des Champs-Elysées, 1930. |
Paru dans le Magazine du Bibliophile, n° 89, octobre 2010.